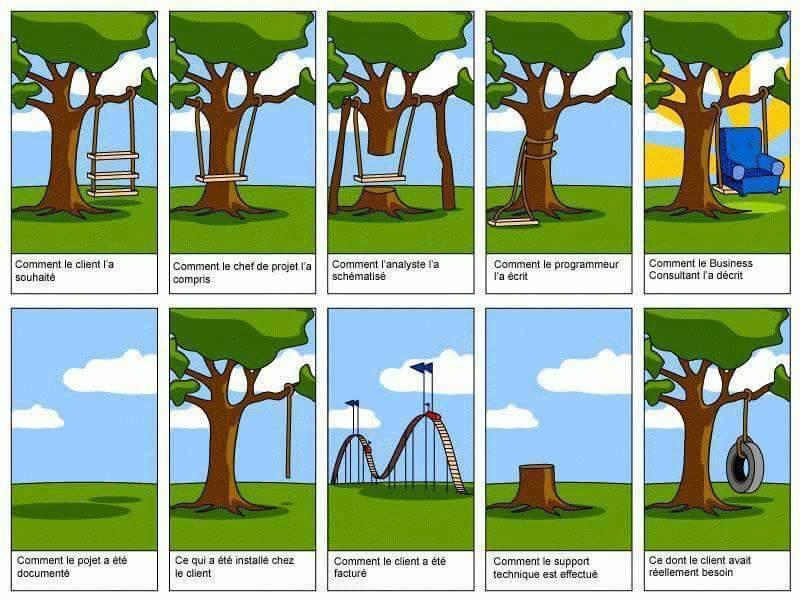Oui, le titre est contradictoire : si c’est tacite, il n’y a pas de formalisme.
Et pourtant… Pour tous les maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas le formalisme de l’acte de construire et notamment qui ne font pas de réception en bon et dû forme, et bien oui quand il y a réception tacite l’un des multiples désavantages est qu’en plus n’importe qui ne peut pas s’en prévaloir.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z…ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X…a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu’invoquant des désordres, M. et Mme Z…ont assigné la société Yvon Boyer et M. X…en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y…;
Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l’arrêt de dire que le GAN n’est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z…, alors, selon le moyen, que la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z…habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z…la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Yvon Boyer
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que la société GAN Assurances n’est pas tenue de garantir la SARL Yvon Boyer des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Z…sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le fondement de la demande
Pour se prévaloir d’une réception tacite des travaux ouvrant droit à garantie décennale conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil il appartient à la société Yvon Boyer de prouver que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, mêmes avec réserves.
Elle se contente d’indiquer que M. et Mme Z…habitaient l’immeuble sans difficultés mais n’a pas contesté leurs dires selon lesquels ils habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin objet des désordres, et ne peut contester leurs réclamations faites par lettres recommandées des 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclame une somme de 53 010, 78 euros pour solde de facturation. En l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et c’est à raison que le premier juge a retenu le fondement contractuel sur lequel M. et Mme Z…recherchent sa responsabilité »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
« les époux Z…recherchent la responsabilité de la SARL Yvon Boyer pour les désordres relevés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en raison des manquements à ses obligations contractuelles »,
1) ALORS QUE la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil ;
ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Yvon Boyer auprès du GAN excluent de la garantie, article 2, les » dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré « .
La société Yvon Boyer demande l’annulation de cette clause qui serait contraire à l’article L. 113-1 du code des assurances et viderait le contrat de sa substance et permettrait à l’assureur de ne pas prendre en charge les fautes commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession.
Cependant, la clause litigieuse n’est pas contraire à cet article qui, énonçant que » les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police « , ne vise que les cas fortuits (tempête, ouragan, cyclones, grêle et neige) et les actes commis volontairement dans l’intention de causer un dommage.
Les dommages entraînant la responsabilité de la société Yvon Boyer étant relatifs à des ouvrages qu’elle a exécutés, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit le GAN non tenu à garantie »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande de garantie du sinistre formée par la SARL Yvon Boyer à l’encontre de la SA GAN Assurances
La SARL Yvon Boyer sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances GAN Assurances à la garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre au profit des époux Z…en application de la police d’assurance souscrite par elle auprès de GAN Assurances ;
la société d’assurance conteste devoir sa garantie au motif que le contrat souscrit ne couvre pas les risques liés à la responsabilité civile professionnelle de l’assuré pour des désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assurée est engagée ;
Il convient d’observer que les demandes des époux Z…à l’encontre de la SARL Yvon Boyer ayant été formées exclusivement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la question de la garantie de GAN Assurances ne peut être examinée qu’au regard de la couverture ou non des risques liés à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
or, il résulte de l’examen des conditions générales du contrat, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Yvon Boyer, que la société d’assurance ne couvre pas, dans le cadre de la responsabilité civile de l’assurée encourue en cours d’exploitation ou d’exécution de travaux, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
la société GAN Assurances apparaît en conséquence fondée à refuser sa garantie à la SARL Yvon Boyer ;
La SARL Yvon Boyer sera ainsi déboutée de sa demande »,
2) ALORS QUE pour être valables, les clauses d’exclusion de garantie insérées dans une police d’assurance doivent être formelles et limitées, cette exigence de portée générale s’imposant quelle que soit la cause d’exclusion de garantie invoquée ; qu’en écartant la demande de l’assuré en nullité de la clause d’exclusion litigieuse pour n’être ni formelle ni limitée, au motif erroné que l’article L. 113-1 du code des assurances ne viserait que les cas fortuits comme une tempête, un ouragan, des cyclones, la grêle ou la neige ainsi que les actes commis volontairement dans l’intention de causer le dommage, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances par refus d’application ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles ne vident pas le contrat de sa substance ; qu’en rejetant la demande de l’assuré en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, par sa généralité, vidait le contrat d’assurance de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE les clauses d’exclusion formelles et limitées insérées dans une police d’assurance sont valables à condition qu’elles soient dénuées d’ambiguïté et permettent à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie ; qu’en rejetant la demande de l’entrepreneur en nullité de la clause excluant la garantie de l’assureur pour « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils appartiennent ou non à l’assuré », cependant qu’une telle clause, insérée dans un paragraphe relatif à la responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers, n’était pas exempte d’ambiguïté et ne mettait pas l’assuré en mesure de connaître l’étendue exacte de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »